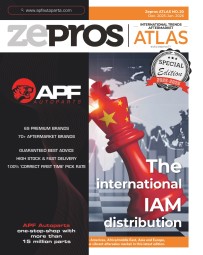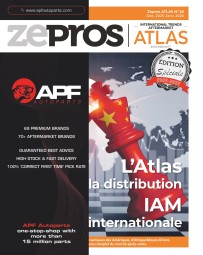
Carrossier, un métier à remettre dans le bon sens

Présentée sur Equip Auto 2025, l’étude menée par Weinmann Technologies et l'Université de Toulouse révèle un décalage représentatif inquiétant entre les générations. Au cœur du problème : un glissement sémantique et une perte de sens qui s'accentuent avec les années.
Les chiffres parlent : 10 000 besoins en carrossiers et peintres, seulement 7 000 recrutements aboutis selon l’ANFA. 38% des recrutements sont jugés difficiles à réaliser, et 30% des besoins ne sont tout simplement pas pourvus. Face à cette pénurie chronique, l’étude menée par Lucile Courtois, docteure en sciences de l'éducation et directrice des ressources humaines de Weinmann Technologies, et Michel Lac, chercheur à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, démonte l’idée que la pénurie de main-d'œuvre serait liée à une représentation sociale négative du métier. Les résultats ont en effet révélé une réalité bien plus complexe : le problème ne vient pas tant de l'image externe que de la façon dont les pros eux-mêmes perçoivent et transmettent leur métier.
Malentendu générationnel
Là où les jeunes en formation perçoivent un métier facile à apprendre, valorisant, bien payé, moderne, simple et écologique, les dirigeants et carrossiers dressent un portrait inverse : difficile, artisanal, dévalorisant, mal payé, traditionnel, compliqué et polluant. « Une image résolument passéiste et plutôt négative qui contraste avec une image plus moderne et positive chez les futurs carrossiers », souligne Lucile Courtois. Ce paradoxe est d'autant plus frappant que 17 000 jeunes se forment actuellement à la carrosserie-peinture (+30% depuis 2017).
Les candidats sont là, motivés, mais se heurtent à un mur d'incompréhension. « À force de mal se comprendre, on finit par ne plus réussir à travailler ensemble », constatent les chercheurs. Et chacun finit par pointer l'autre comme le problème : les jeunes seraient "trop fragiles", "pas assez motivés", tandis que les patrons seraient "déconnectés", "exigeants". Un dialogue de sourds qui empoisonne la transmission.
La passion, un cache-misère ?
« Pour faire ce métier, il faut être passionné. » La phrase revient en boucle dans le secteur, comme un mantra incontestable. Mais l'étude révèle qu'elle revêt deux significations radicalement opposées. Pour les plus jeunes, elle constitue une source de satisfaction, de valorisation professionnelle et un marqueur identitaire fort. Pour les plus âgés, elle vient simplement compenser des conditions de travail délétères. Le fossé se creuse également sur la notion de difficulté. Les jeunes considèrent le métier comme « simple mais difficile dans ses conditions d'exercice ». Les carrossiers installés le jugent au contraire « compliqué, impliquant des qualités intrinsèques rares voire indéfinissables ».
Résultat : l’employeur recherche le carrossier parfait dès le départ, idéal inaccessible qui décourage les vocations naissantes. L'étude pointe une confusion systématique chez les professionnels installés. On confond « savoir-faire et savoir-être, compétence et endurance, amour du métier et sacrifice, formation et formatage ». Des amalgames qui brouillent les repères, transforment l'apprentissage en rude épreuve initiatique… et rendent la transmission impossible. L'étude pointe en outre que le métier s'est enfermé dans un jargon, des codes et des représentations qui l'éloignent des nouvelles générations.
Le temps, ennemi de la transmission
Les dirigeants entretiennent un rapport ambivalent à la formation : tantôt niée, tantôt valorisée, souvent jugée inadaptée. Le verdict des chercheurs est sévère : « On ne forme pas les carrossiers de demain, on forme les carrossiers d'hier avec les jeunes d'aujourd'hui ». Cette inadéquation alimente une déperdition massive. Car nombreux sont ceux qui ne restent pas dans le métier. Le problème n'est donc pas l'attractivité initiale, mais l'intégration et la pérennisation. L'étude met également en évidence un conflit de temporalités qui mine la profession. La logique de formation s'inscrit dans le temps long, celui de l'apprentissage progressif, de la maturation des compétences et de l'appropriation des gestes.
La logique économique, qui s’impose en toute violence au chef d’entreprise, impose un temps court, celui de la rentabilité immédiate, des cadences soutenues et de la productivité mesurable dès les premiers jours. « Dans ce contexte, le métier ne se transmet plus, il se subit ou il se quitte », déplore les chercheurs. Les jeunes n'ont pas le temps d'apprendre à leur rythme, de comprendre la subtilité des gestes. Les tuteurs n'ont pas le temps de transmettre correctement, pris dans l'urgence quotidienne. Le temps, ressource indispensable à tout apprentissage de qualité, est devenu la principale variable d'ajustement, avec des conséquences dramatiques sur la transmission. Or, « le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui », soulignait Xavier Horent, délégué général de l’organisation professionnelle Mobilians, lors de la présentation de l’étude.
Un glissement révélateur
Mais le symptôme le plus inquiétant reste peut-être ce glissement sémantique observé chez les carrossiers et dirigeants. Au fil du temps, le pro ne parle plus de "voiture", mais de "véhicule" ou d'"automobile". Un changement de vocabulaire qui peut sembler anodin, mais qui traduit en réalité "une perte de sens" profonde, selon les chercheurs. « On vibre pour la voiture mais on traite des véhicules, dans le secteur de l'automobile », résume L. Courtois. Le véhicule est une unité économique, l'automobile est un secteur d'activité. Et plus personne ne parle de la voiture, cet objet qui fait rêver et qui justifiait jadis qu'on lui consacre sa vie professionnelle.
Cette désincarnation progressive du métier érode son attractivité autant que la motivation de ceux qui l'exercent. En perdant le vocabulaire de la passion, on perd aussi la capacité à transmettre ce qui fait vibrer. Ce glissement linguistique inconscient dit tout de la façon dont le sens du métier s'est progressivement dilué au fil des années et de la carrière. Les chercheurs appellent donc à un changement radical de perspective. Leur recommandation ? « Écoutons les jeunes. Ils portent en eux le cœur du métier, son avenir, sa mémoire ». Car ils arrivent avec un regard neuf, une vision positive, moderne et n'ont pas encore été contaminés par le pessimisme ambiant.